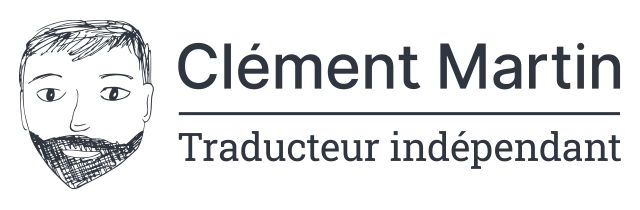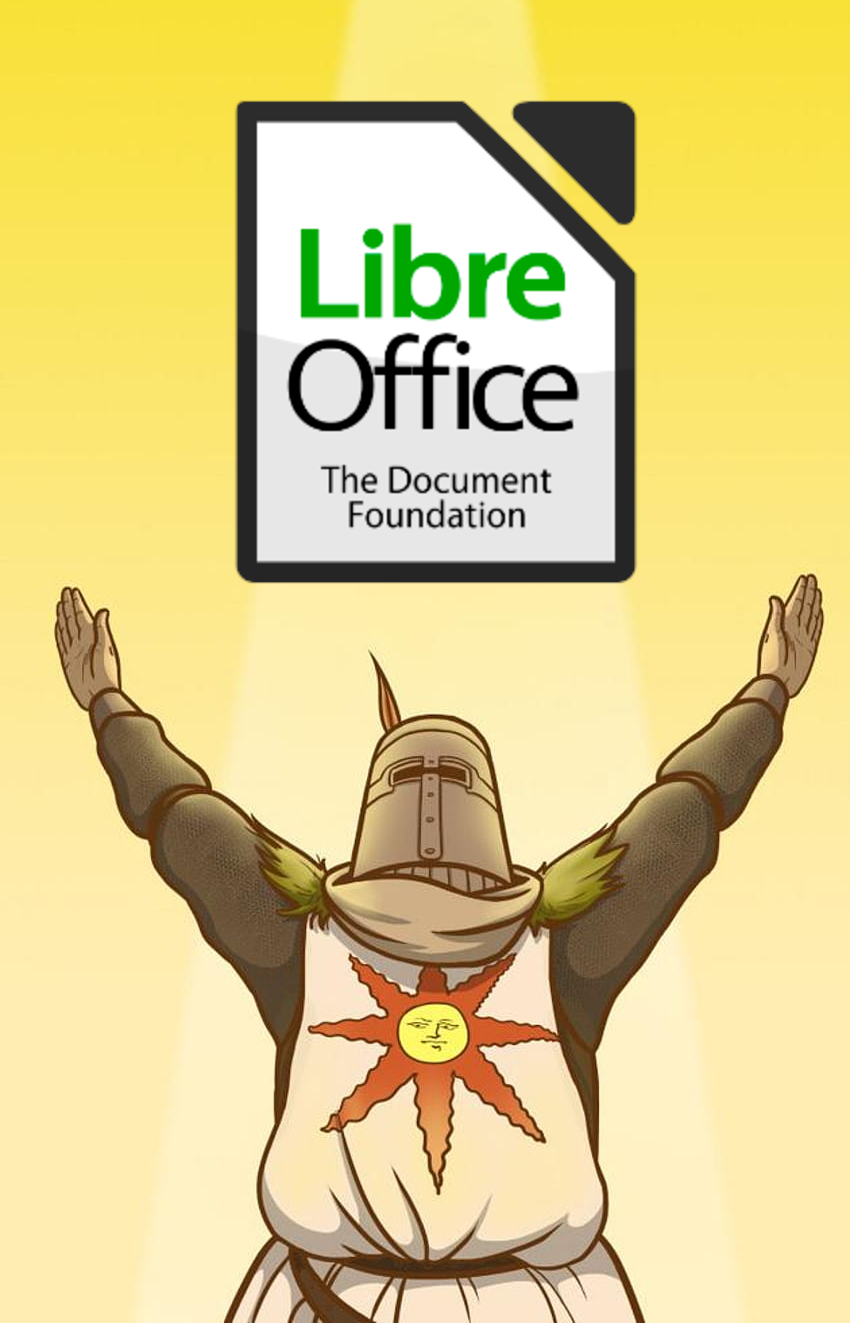Il y a quelques semaines, je vous parlais des réseaux sociaux, et de comment je voulais m’en défaire pour que mon auto-promotion ne dépende plus des lubies de grands patrons. Dans un même mouvement de, disons, dégooglisation au sens large, je me suis dit que j’allais essayer d’étendre cette attitude au reste de mes outils de travail. C’est donc l’occasion de faire le point dans ce petit billet sur ceux que j’utilisais quotidiennement en tant que traducteur de l’anglais, et ceux que j’utilise désormais.
Mais de quoi a-t-on besoin, quand on est traducteur ? Réfléchissons :
- D’un clavier d’exception. Ça, c’est bon ;
- D’un traitement de texte ;
- Quand on fait de la localisation de jeu vidéo, d’un tableur ;
- De dictionnaires plus ou moins spécialisés ;
- D’un logiciel de correction.
Le traitement de texte/le tableur
Vu que mon cœur de métier consiste à produire en grande quantité du texte correctement mis en page, le traitement de texte est un indispensable. Jusqu’ici, je me servais de Microsoft Office 2016. Celui-ci ayant cessé de fonctionner après la réinstallation de trop, j’ai fini par céder aux sirènes de l’abonnement Microsoft 365, ce qui, même si l’idée de m’abonner à un logiciel m’agace, fonctionnait plutôt bien. Mais il a évidemment fallu que Microsoft décide de forcer les utilisateurs à utiliser son affreux assistant IA, Copilot, et pour toutes sortes de raison que j’évoquerai dans un autre billet, ce sera sans moi. Exit Word et Excel, donc ; place à LibreOffice !

Sans rentrer dans toute la généalogie du projet, contentons-nous de rappeler que LibreOffice est une suite bureautique gratuite et open source développée par la Document Foundation et soutenue par la Fondation pour le logiciel libre. En l’installant, je craignais le pire, l’ayant essayée pour la dernière fois au milieu des années 2010, époque où la suite était… perfectible. En le lançant, une première surprise : si l’interface n’est pas aussi léchée que celle des derniers produits Microsoft, elle est très pratique une fois que l’on a pris ses repères, et certains raccourcis claviers sont même plus logiques.
Que ce soit donc pour le traitement de texte ou le tableur, le passage de MSOffice à LibreOffice s’est fait sans douleur (passé des choix de design différents, comme le surlignage du texte qui n’est pas géré de la même façon). LO s’avère même plus rapide sur les documents volumineux (romans, tableaux de milliers de ligne), et je n’ai eu aucun problème de compatibilité de format. C’était ma principale crainte : ne pas pouvoir échanger avec des éditeurs via le système de suivi des modifications ou de commentaires de MSOffice. Mais, miracle : MSOffice lit facilement les commentaires des documents LO, et inversement.
Bien sûr, le changement sera moins aisé si vous avez un usage plus approfondi que le mien (si vous utilisez par exemple les outils de collaboration en ligne MSOffice). Mais pour un indépendant qui veut simplement rédiger des documents propres, cela fait parfaitement l’affaire. Et en bonus : pas de vilain assistant IA en vue. Parfait.
Pour télécharger la suite LibreOffice, c’est par ici.
Les dictionnaires/la correction
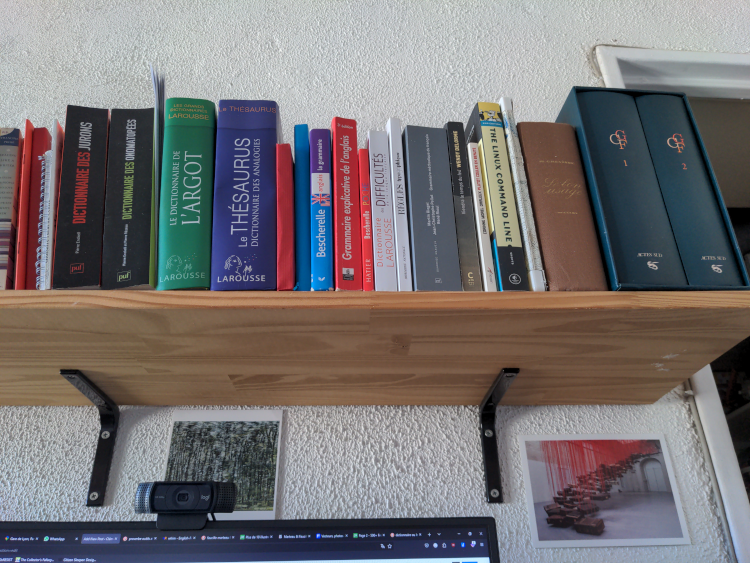
J’aime les dictionnaires.
Je pourrais passer pas mal de temps à disserter sur les mérites de chacun de ceux dans l’image ci-dessus (non, il n’y a pas que des dictionnaires, oui, ça n’est pas très bien rangé, laissez-moi), ou bien à dire tout mon amour du Thésaurus de Larousse, qui n’est PAS un dictionnaire de synonymes. Je me contenterai de dire que ce sont des outils essentiels… auquel je n’ai pas si souvent recours parce que la plupart du temps, mes multiples dictionnaires en ligne me suffisent. Pêle-mêle :
- Wordreference, dictionnaire multilingue avec un forum assez actif où poser des questions compliquées ;
- Le Trésor de la Langue informatisé, dictionnaire français dont la rédaction s’est arrêtée en 1994, mais qui est un véritable… trésor, notamment sur l’étymologie ;
- Le merveilleux Dictionnaire Électroniques des Synonymes, mieux connu sous le nom du CRISCO (en fait le nom du laboratoire qui l’a développé). Simplement le meilleur dictionnaire de synonymes en français ;
- Le Robert en ligne, dictionnaire français, peut-être celui où les mots nouveaux apparaissent le plus rapidement (à l’exception du wiktionnaire) ;
- Le Cambridge English Dictionary, dictionnaire unilingue anglais, pour les références plutôt britanniques (que j’approfondis avec l’Oxford English Dictionary, dont l’accès est limité)
- Le Merriam Webster, dictionnaire unilingue anglais, pour les références plutôt américaines.
À ceux-là s’ajoutent quelques références plus spécifiques :
- La Vitrine linguistique, dictionnaire bilingue développé par l’Office québecois de la langue française, très utile pour les nuances d’usage et le vocabulaire technique ;
- Le très pratique Dictionnaire des cooccurrences (encore une référence canadienne) pour savoir si, vraiment, on a le droit d’associer ces deux mots-là ;
- L’Online Etymology Dictionary, pour l’étymologie des mots anglais.
Dès que je travaille sur une traduction, tous ces dictionnaires sont ouverts dans mon navigateur. Cependant, ils ont failli se faire supplanter par le couteau-suisse du scribouillard : Antidote.
Non content d’être un logiciel de correction extrêmement performant (qui permet notamment de se créer ses dictionnaires personnels, d’y intégrer des néologismes en leur attribuant une catégorie pour qu’ils s’accordent d’eux-mêmes etc., bien pratique quand on traduit des littératures de l’imaginaire), Antidote intègre une flopée de dictionnaires. Synonymes, antonymes, cooccurrences, champ lexical, familles de mots, rimes, citations… tout y est. C’est très pratique !
Et même trop, parce qu’au bout d’un moment, on se trouve piégé de cet écosystème. Par ailleurs, Antidote fonctionne mal sous Linux, c’est encore une entreprise qui vous pousse à prendre un abonnement (grrr), et eux aussi veulent à tout prix vous refourguer un outil de reformulation IA. Donc, exit Antidote.
Moins facile de trouver une alternative libre que pour MSOffice. Si je n’ai pas trouvé de correcteur bilingue, il existe cependant pour le français le logiciel Grammalecte, qui a le bon goût de s’intégrer à LibreOffice et de ne faire que de la correction, sans prendre la place de tous les dictionnaires.
Pour télécharger Grammalecte, c’est par ici.
En conclusion
Ce ne sera pas une surprise pour les libristes, mais il est donc tout à fait possible de traduire professionnellement et dans un certain confort pour la modique somme de zéro euros. (Ce qui ne nous dispense pas de contribuer comme on peut à ces projets bénévoles, ou a minima de leur faire un don. Mieux vaut toujours leur donner de l’argent à eux qu’à Microsoft.)
Il existe une foule d’autres outils libres formidables, et j’y reviendrai dans un prochain billet. En attendant, allez les essayer !