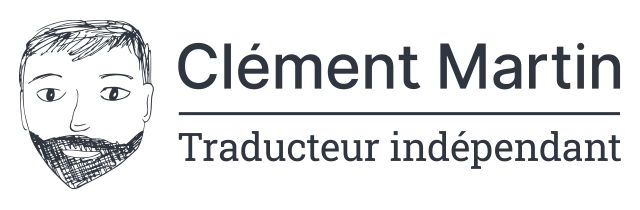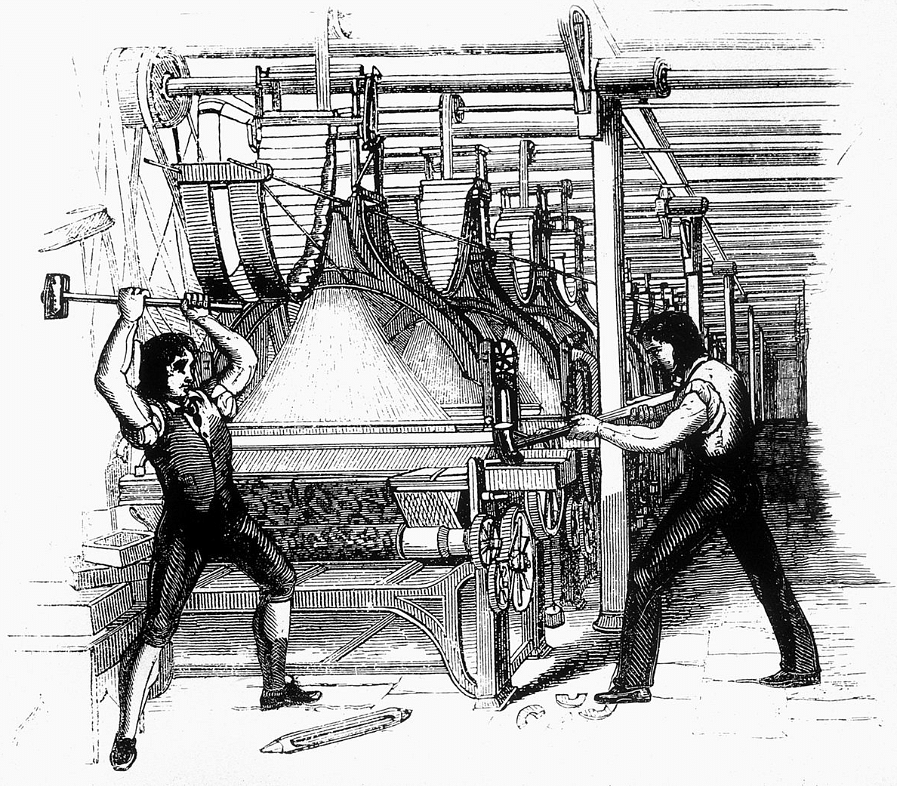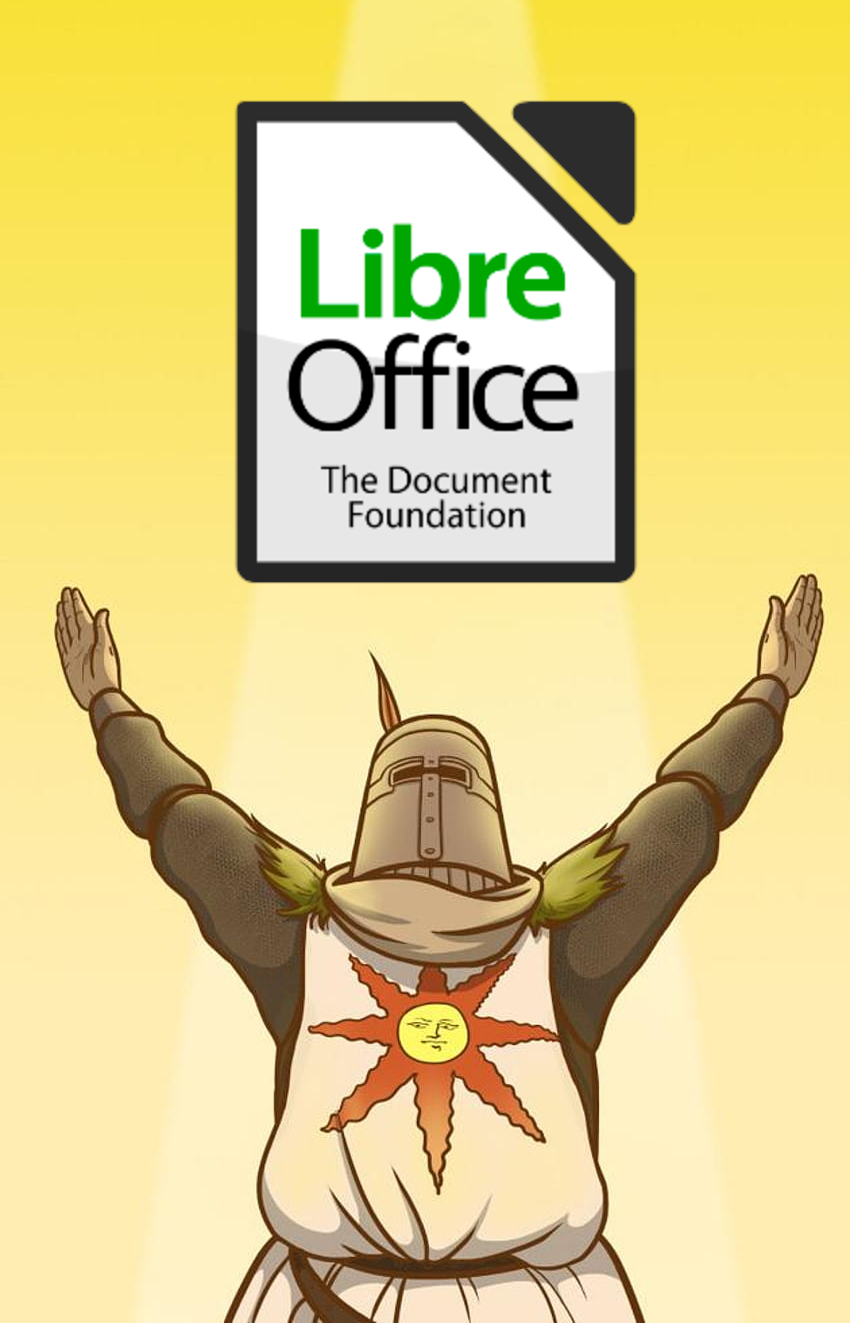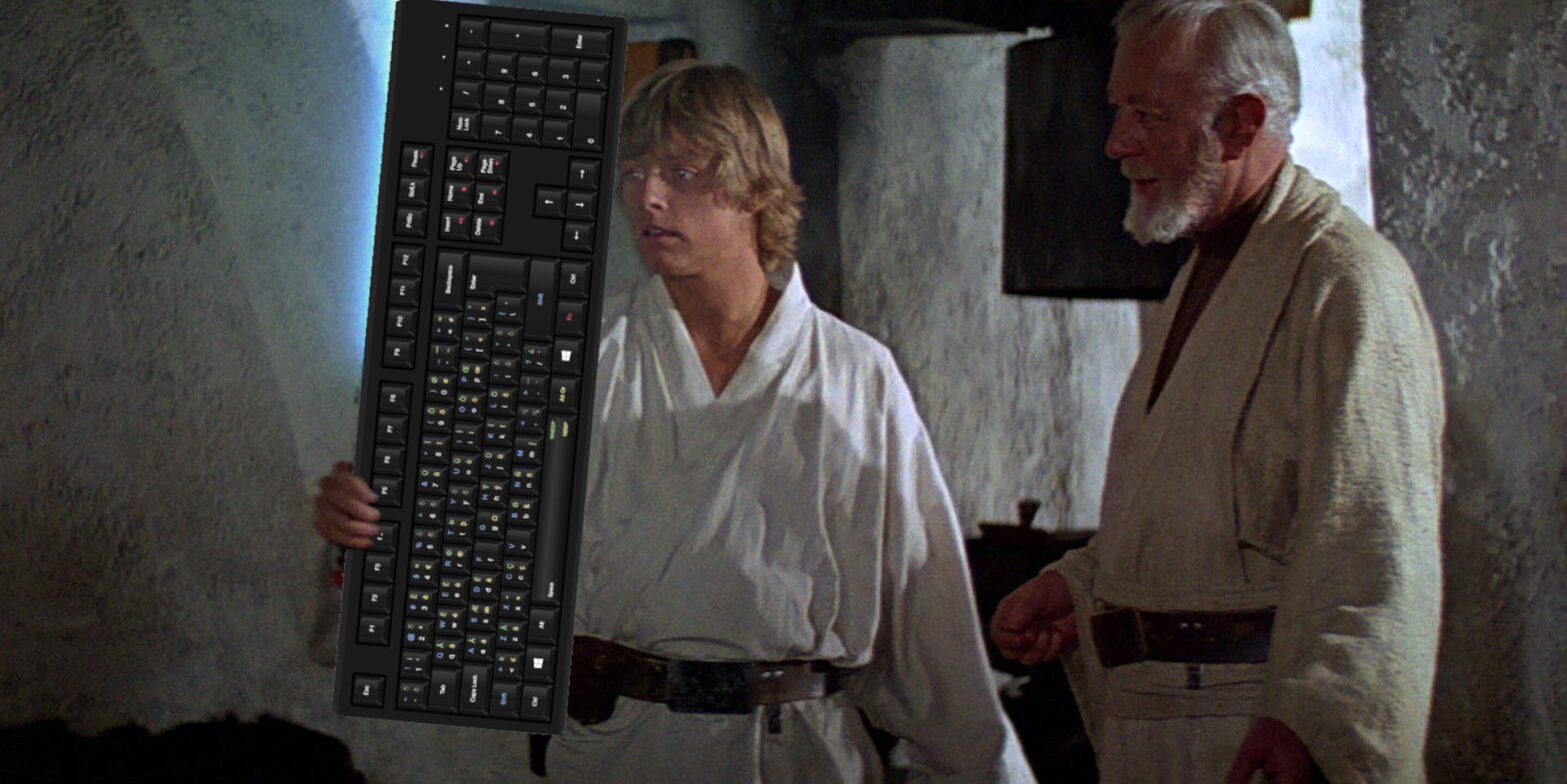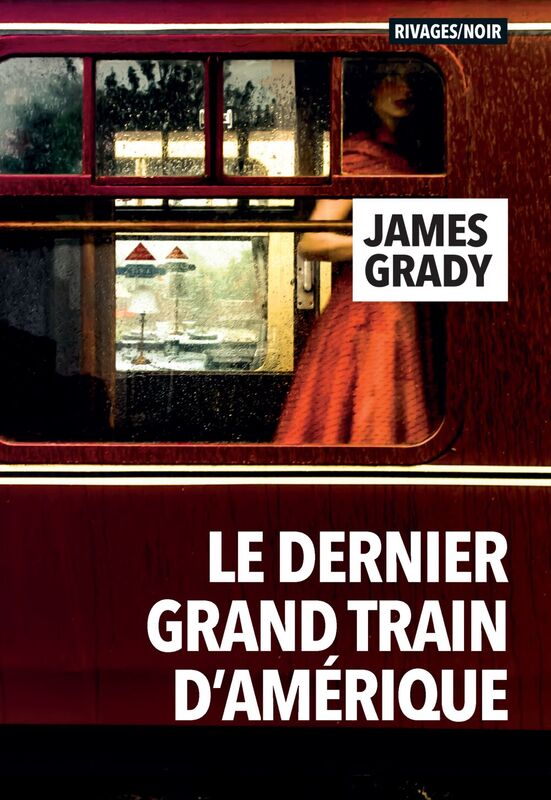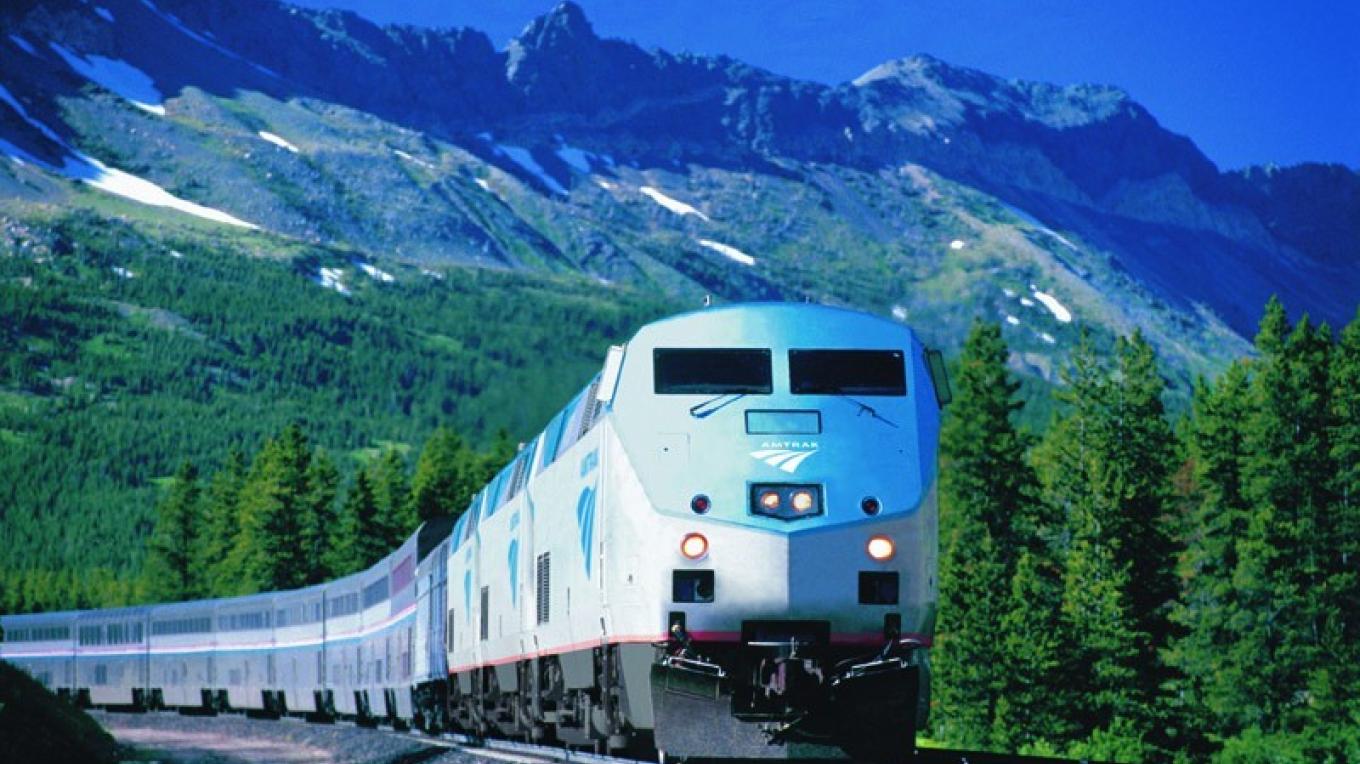C’est la question qu’on me pose invariablement quand je dis que je suis traducteur. Parfois, le sous-entendu est « C’est utile ? Tu t’en sers ? » ; parfois, c’est plutôt « Alors, ce chômage, c’est pour quand ? » Et la question est légitime ! Je suis raisonnablement technophile (je me suis quand même fait fabriquer un clavier !), alors pourquoi est-ce que, en tant que traducteur, je n’utiliserais pas un outil de traduction comme il y en a tant ?
Pour de nombreuses raisons (et parce que j’ai le choix de ne pas le faire ; ce n’est pas le cas de tout le monde, j’y reviendrai). Avant que je les expose, une clarification s’impose : j’emploie l’expression « IA » (= intelligence artificielle) car c’est le terme employé un peu partout à l’heure actuelle pour désigner les grands modèles de langage (outils d’intelligence artificielle générative dont le plus connu est ChatGPT, produit par la société OpenAI) et dans une moindre mesure les logiciels de traduction automatique neuronale (comme DeepL). Ce sont ces « outils » auxquels je m’oppose. Je n’ai rien contre les IA qui aident à décoder le génome, à prévoir les catastrophes naturelles, ou à me faire croire que je suis intelligent quand je joue aux jeux vidéo. Je ne suis pas technophobe et j’ai une cible précise quand je parle d’IA.
Ce point évacué, voyons pourquoi je suis contre l’IA en traduction.