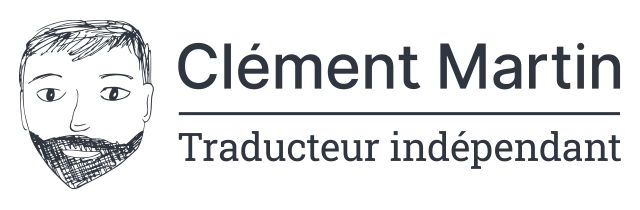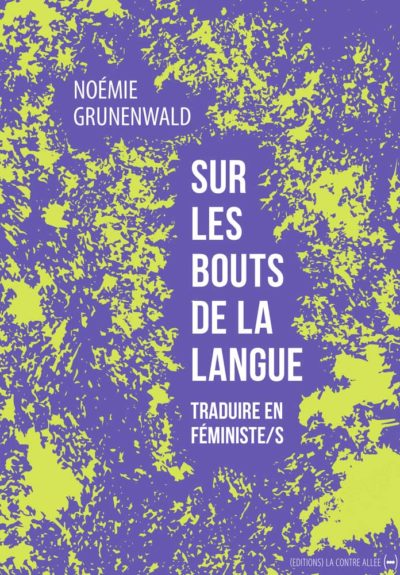
Trois mois que j’ai fini ce livre, et ce n’est que maintenant que je me résous à écrire ce billet. Sur les bouts de la langue m’impressionne. Non pas que ce soit un texte inapprochable, comme peuvent l’être certains grands classiques de la traduction (« la tâche du traducteur » de Benjamin, par exemple). Au contraire, l’essai de Noémie Grunenwald est écrit dans une langue simple, accueillante. Mais il n’est certainement pas dénué de profondeur, et il fait quelque chose d’important. Ce bref billet n’y rendra sûrement pas justice, mais j’espère qu’il vous donnera envie de le feuilleter.
Beaucoup d’essais théoriques portant sur la traduction sont articulés à des œuvres, leur pendant pratique : l’essai de Benjamin a ainsi servi de préface à sa traduction des Tableaux parisiens de Baudelaire. J’ai cependant l’impression que, dans de nombreux cas, quand je suis face à un texte théorique côte-à-côte avec un texte résultant d’une pratique de la traduction, je peine à sentir le lien entre théorie et pratique. Ce n’est pas le cas ici. Tout au long de l’essai, l’autrice associe la pensée et le faire. J’en veux pour preuve ses chapitres, qui sont autant de verbes exprimant un aspect de ce qu’est traduire : s’abandonner, improviser, se soumettre, (se) décentrer, interpréter, corriger, élargir, inclure ?, apprendre, tisser, citer.
C’est tout ça, traduire. Avant même de coucher des mots sur le papier, c’est créer les conditions matérielles de la traduction, et les improviser en se trouvant un petit boulot. C’est interpréter un texte et amener une autrice à penser au genre du« thinkers » qu’elle a employé, puis préciser son texte en le confrontant à une autre langue. C’est inclure en se demandant à quel imaginaire on veut renvoyer en traduisant « workers » : la camaraderie syndicaliste virile de « travailleurs », ou une plus grande exactitude historique, dans ce cas, des « travailleuses ». C’est apprendre à trouver les bons néologismes pour de nouveaux concepts, se tromper parfois, mais toujours être prêt·e à recommencer. C’est citer, car on ne saurait oublier que la traduction est toujours une activité collective. Et c’est aussi, souvent, faire une montagne de recherches sur Google ou le dictionnaire de synonymes du CRISCO, choses anodines que Grunenwald fait pourtant figurer dans son texte car le quotidien, quand on traduit, c’est aussi ça.
Sur les bouts de la langue est un texte très intime, qui rappelle que les traducteurices sont des êtres avec une histoire, un vécu. C’est aussi un texte d’une grande humilité : « Pas besoin de grand talent ni d’inspiration particulière, dit l’autrice. Juste de quelques techniques de manipulation littéraire. » (p. 150) Mais ce n’est pas un texte qui s’excuse d’exister. C’est un texte de combat, qui nous explique que Traduire en féministe/s, ce n’est pas écrire un nouveau manuel, ou créer de nouvelles normes inclusives qui seront bien vite récupérées pour à nouveau exclure, mais bien rester « constamment en mouvement, en cultivant le dérangement. » (p. 100)
Il y aurait mille autres choses à dire sur ce livre : sur la façon dont Grunenwald articule intime et politique, théorie et pratique, vie et traduction. Sur la richesse de sa bibliographie, et la façon dont l’autrice applique tous les enseignements qu’elle en a tirés. Mais j’ai besoin de plus de temps pour le comprendre, le digérer. Je me contenterai donc conclure en disant que c’est un texte à mettre entre toutes les main. Un texte qui m’a donné envie de mieux lire, de réfléchir, de mieux travailler. Qui m’a rappelé la beauté, la difficulté et l’importance de ce métier. Que je n’ai pas fini de relire, aussi longtemps que je traduirai.